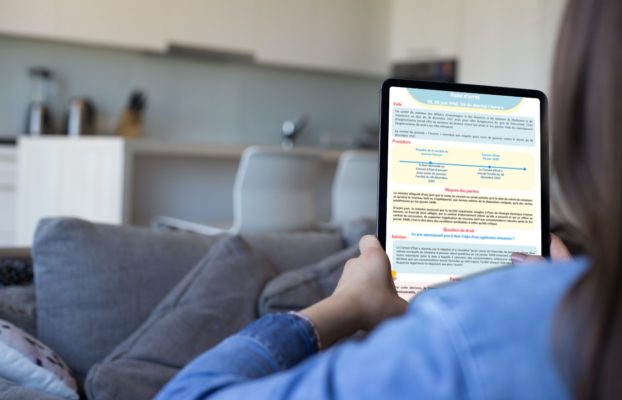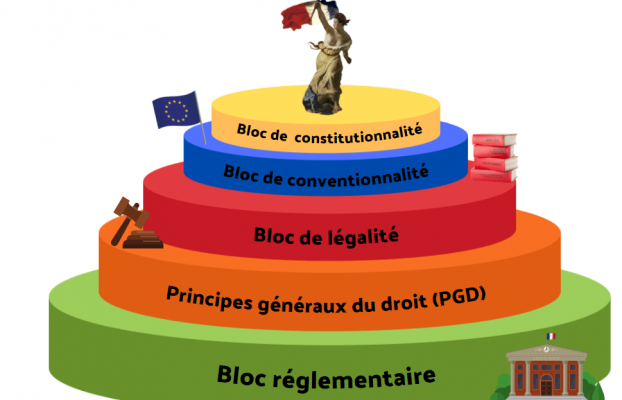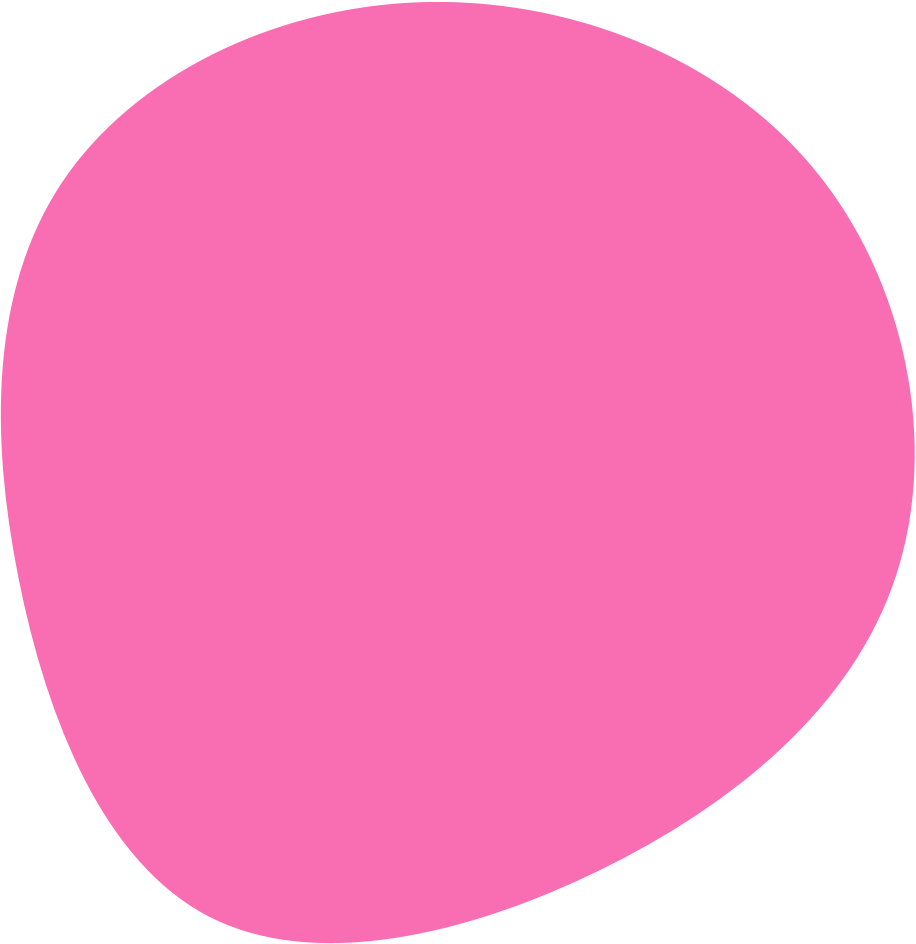En droit des obligations, la responsabilité civile est scindée entre la responsabilité contractuelle impliquant la conclusion d’un contrat et la responsabilité extracontractuelle qui résulte des faits d’une personne.
Sommaire
1. Responsabilité contractuelle : définition
2. Différence entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle
La différence essentielle entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle réside dans l’existence d’un contrat (synallagmatique ou unilatéral) conclu entre la victime et l’auteur du dommage.
Alors que la responsabilité contractuelle implique un manquement contractuel, la responsabilité délictuelle (ou extracontractuelle) suppose la réalisation d’une faute commise en dehors de tout contrat.
Attention : les responsabilités contractuelle et délictuelle ne sont pas cumulables.
Ainsi, un créancier qui aurait subi un préjudice du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle de son débiteur devrait engager sa responsabilité contractuelle à l’exclusion de sa responsabilité délictuelle.
JurisLogic : la plateforme pour réussir tes études de droit
Cours optimisés, fiches de révision, vidéos de cours, Quiz, flash cards… Tout ce qu’il te faut pour faire décoller tes notes !

3. Les conditions de l’action en responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Outre l’existence fondamentale d’un contrat, la responsabilité contractuelle du contractant ne peut être engagée qu’en respectant 3 conditions cumulatives :
Le fait générateur : l’inexécution d’une obligation contractuelle
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée soit à l’inexécution de l’obligation, soit au retard dans l’exécution de l’obligation : c’est le fait générateur.
Autrement dit, la notion d’inexécution contractuelle doit être entendue au sens large, elle peut être totale ou partielle ou consister en une exécution tardive ou défectueuse.
Plutôt que de raisonner en termes de faute, la preuve de l’inexécution suggère de démontrer un manquement contractuel qui implique de différencier obligation de moyens et obligation de résultat.
• S’il s’agit d’une obligation de résultat, le créancier doit seulement prouver que le débiteur n’a pas atteint le résultat stipulé au contrat. Par exemple, le transporteur s’engage à ce que les marchandises arrivent à l’endroit désigné et sans être endommagées. À défaut, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée.
• S’il s’agit d’une obligation de moyens, le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour atteindre le résultat. L’idée est de démontrer une négligence ou une imprudence du cocontractant.
Par exemple, l’obligation du médecin de prodiguer des soins est une obligation de moyens. Sa responsabilité ne pourra être engagée que s’il est établi que le médecin n’a pas exécuté son obligation de manière consciencieuse, attentive et conformément aux données acquises par la science (Cass. 1ère civ. 04/01/2005).
Globalement, on parle d’obligation de résultat lorsque le débiteur a la pleine maîtrise de l’exécution de son obligation et on parle d’obligation de moyens lorsque l’obtention du résultat comporte un aléa.
Le dommage
À l’instar de la responsabilité délictuelle, l’action en responsabilité contractuelle est conditionnée à la démonstration d’un préjudice subi par le créancier.
Le préjudice prévisible : si la responsabilité civile délictuelle est régie par le principe de réparation intégrale, la responsabilité contractuelle est quant à elle gouvernée par le principe de limitation de la réparation au dommage prévisible.
À défaut, en cas de perte ou de détérioration, les dommages-intérêts alloués au créancier ne pourront pas correspondre à leur véritable valeur.
• Une faute lourde : pour la Cour de cassation, il s’agit d’une faute d’une extrême gravité qui dénote l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ». (Cass. mixte 22/04/2005)
• Une faute dolosive : le débiteur choisit délibérément (volontairement) de ne pas exécuter ses obligations contractuelles, peu importe qu’il recherche ou non à causer un préjudice à son cocontractant.
Attention : la démonstration d’un préjudice par le créancier n’est plus nécessaire :
Le lien de causalité
L’article 1231-4 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
En droit de la responsabilité, la jurisprudence recoure généralement à 2 théories pour déterminer la cause du dommage :
En pratique, la Cour de cassation optera pour l’une ou pour l’autre selon le résultat recherché : une conception large de la causalité pour trouver facilement un responsable et une conception plus restrictive pour écarter la responsabilité d’un agent.
4. Limites de la responsabilité contractuelle
Les aménagements conventionnels
Les clauses limitatives de responsabilité
Les parties peuvent, d’un commun accord, prévoir dans le contrat :
• Une clause limitative de responsabilité pour fixer un plafond au montant des dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution contractuelle.
• Une clause exclusive de responsabilité pour exonérer le débiteur de toute responsabilité en cas d’inexécution contractuelle de sa part.
Les clauses pénales
Les contractants sont libres d’insérer une clause pénale dans le contrat, c’est-à-dire, une stipulation par laquelle les parties fixent de manière anticipée le montant des dommages-intérêts dus par l’une des parties à l’autre en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles.
▶En cas d’inexécution totale : le juge peut modérer ou augmenter la pénalité prévue au contrat « si elle est manifestement excessive ou dérisoire » par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier.
▶En cas d’inexécution partielle : le juge peut diminuer la pénalité convenue « à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier ».
Les causes d’exonération prévues par la loi
En dehors des accords de limitation de responsabilité admis entre les parties, il existe 3 cas où le débiteur est légalement exonéré de son devoir de réparation :
La force majeure est un évènement à la fois extérieur qui est indépendant de la volonté du débiteur, imprévisible qui ne peut avoir été raisonnablement prévu dès la conclusion du contrat et irrésistible qui ne peut être évité et échappe au contrôle du débiteur (article 1218 du Code civil). Ex : incendie, ouragan, etc.
Les articles 1231-1 et 1351 du Code civil indiquent qu’en cas de force majeure, le débiteur de l’obligation contractuelle jouit d’une exonération totale.
Attention : cette hypothèse n’est une cause d’exonération de la responsabilité contractuelle du débiteur que s’il est constitutif d’un cas de force majeure.
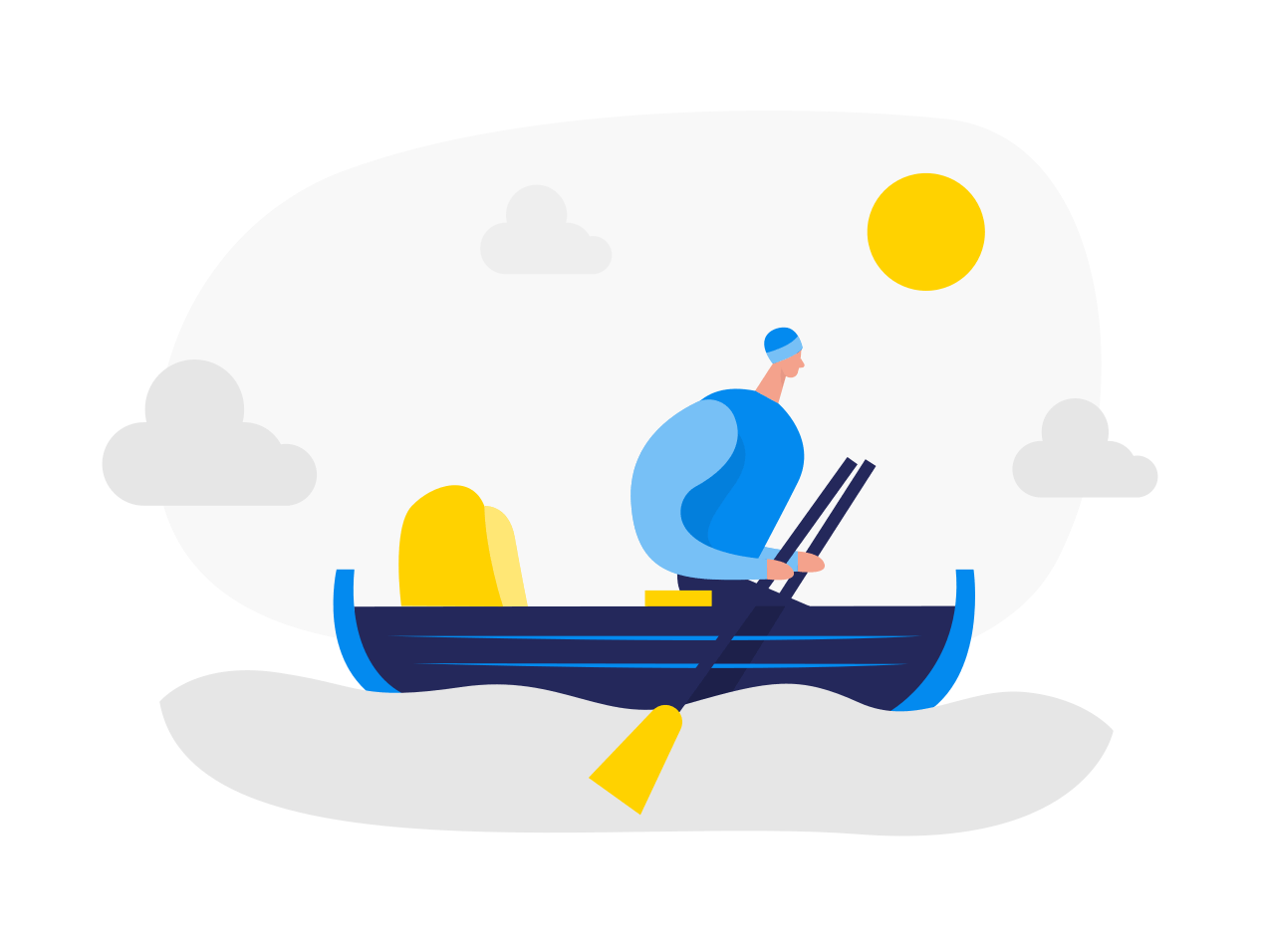
Besoin d'améliorer tes notes en droit des obligations ? Découvre JurisLogic.
La licence de droit n’est pas un long fleuve tranquille mais rien ne t’empêche d’apprendre le rafting.
Chez JurisLogic, le droit, on en a fait de l’eau.